Des violences populaires comme miroir révélateur de violences légitimes d’État, une impasse mortifère pour tous ?
Au printemps 2017, Emmanuel Macron nous a épargnés d’une honte en arrivant au premier rang, lors du premier tour de l’élection présidentielle. Il a ainsi devancé la candidate de l’extrême droite, dont le parti compte nombre d’adeptes de la violence politique et de l’idéologie nazie. Pour les électeurs dont il a obtenu les voix au premier tour, nous pouvons leur en être reconnaissants, et lui en être reconnaissants. Malheureusement pour notre pays, pour nous et pour lui, cette reconnaissance ne s’est pas avérée réciproque.
Dès après son élection, nous avons vite compris que la raison majeure l’ayant placé au premier rang a été oubliée de lui. Quelle raison ? Dans plusieurs de ses déclarations portant sur de grandes questions socio-historiques, il s’est montré être un humaniste sincère et seul capable, eu égard à la désagrégation des deux ex grands partis de gouvernement, d’endiguer la résistible ascension des idées manipulées par l’extrême droite. Si nombre d’électeurs lui ont donné leur voix dès le premier tour, puis, si d’autres ont ajouté la leur au second, c’est pour cette seule et unique raison. Ces voix ont fait la différence. Ce sont celles de citoyens et d’électeurs qui n’ont pas oublié l’effroi éprouvé devant le monde au soir du 21 avril 2002, lorsque nous avons appris que Lionel Jospin était arrivé en 3ème rang et non en deuxième.
En 2017 en effet, au premier tour, Emmanuel Macron aurait pu arriver derrière Madame Le Pen pour plusieurs raisons cumulées et fort complexes : la multiplication des fragmentations de la société française avec son corollaire, le nombre des candidats en concurrence, l’envahissement d’un monde se globalisant et devenant sans limite, dissolvant ainsi la permanence des fonctions protectrices des cadres sociaux vécus comme intangibles, activant en chacun des angoisses ancestrales devant toutes les inconnues, l’instabilité et les fureurs du monde, l’évaporation de la culpabilité collective née des horreurs et de l’abjection des totalitarismes du Vingtième siècle qui avait provoqué bien des sursauts héroïques et un regain de la conscience morale comme celle du bien commun, l’incapacité largement partagée des dirigeants successifs à trouver et à mettre en œuvre des remèdes politiques efficaces ou durables aux maux actuels, dont la croissance des inégalités avec, pour conséquence, la perte de confiance dans les vertus du modèle actuel de la représentation démocratique. Dans un tel environnement, la responsabilité et l’action politiques sont des plus difficiles, c’est certain.
L’art de la responsabilité dans l’action publique et politique
Le signe révélateur du déficit de reconnaissance de la représentation nationale s’observe depuis des années dans les nombres très élevés des abstentions aux différentes élections. En conséquence, rapportées au nombre des électeurs inscrits, les majorités sortant des urnes ne sont que très relatives.
Cependant, pour gagner une élection que faut-il dire et à qui s’adresser ? Pour attirer à lui jeunes et moins jeunes, Emmanuel Macron a voulu incarner une génération nouvelle, libérée d’un habitus, étriqué selon lui, trop lié à l’héritage des républiques précédentes, pris dans les œillères attribuées à ses prédécesseurs et à leurs majorités. Il n’a pas hésité à annoncer qu’il allait initier une nouvelle manière de faire de la politique en se montrant animé par une conception non partisane de l’action politique, prenant en compte et à bras le corps, en même temps, ce qu’on appelle en France, la Gauche et la Droite, ou encore les contraintes antagoniques de toute société. Toutefois, et ce n’est pas un scoop, il est fort difficile de trouver des voies raisonnées de négociation et de conciliation entre les parties antagoniques d’un corps social, notamment quand l’une des catégories d’acteurs au moins tient à rester en antagonisme radical, rendant bien aléatoire la construction d’un « Nous », d’un en commun qu’une instance de gouvernement est censée savoir et devoir incarner.
Ce qui fait que chaque leader d’un fragment du corps social cherche à faire accréditer l’idée qu’il parle au nom de tous, du Nous, du Peuple. Or, de nos jours, même les différents élus de la République ne sont pas investis comme représentant ce Nous. Ce Nous reste une fiction. Et, pourtant, il faut bien chercher à en créer les conditions de possibilité.
En effet, en certaines circonstances historiques, si l’on conçoit la conflictualité collective selon un modèle dynamique et dialectique, il est possible, en œuvrant avec les parties prenantes, de parvenir à concilier des oppositions ou des contraintes vécues, conçues, ou affirmées, a priori, comme inconciliables. C’est justement dans cette capacité à articuler des forces sociales et politiques, aux intérêts a priori opposés, que repose l’art de la responsabilité publique et de l’action politique, laquelle consiste à transformer la conflictualité destructrice et anéantissante en conflictualité dynamique et créatrice et restauratrice du lien social, sinon du contrat social, régulièrement entamé.
Le bien public ou le bien commun sont hétérogènes au capitalisme financier
En réalité, depuis son investiture comme président de la République, Emmanuel Macron a donné l’image d’un homme clivé : il semble fabriqué de deux parts en lui qui ne communiquent pas entre elles ; comme si l’humaniste en lui avait son autonomie propre, de même, comme si l’observant sinon le protecteur du capitalisme financier en lui, avait aussi son autonomie propre. Or, par « nature », le capitalisme financier et ses détenteurs ne fondent pas leur intérêt sur le bien public ou les intérêts collectifs, ou sur la construction d’intérêts communs et des relations de coopérations nécessaires entre les différents pays du monde. Avec une telle scission de l’esprit, un travail de dépassement et de conciliation entre forces contraires ne peut être sérieusement entrepris. Cette scission semble même entretenir en lui une inclination à dire des propos moqueurs expulsant du corps social celles et ceux qui ne pensent pas comme lui en les dépouillant de toute raison, de toute qualité.
Or, un travail de conciliation créatrice du bien commun ne peut être effectué que dans un nouvel espace politique potentiel intermédiaire créant les conditions propices à l’engagement des uns et des autres, à l’accès à la sensibilité à autrui et au sens de la réciprocité. Ce nouvel espace politique potentiel commun reste à inventer, si ses protagonistes veulent construire et rendre possibles des relations et régulations sociétales, fondées sur la reconnaissance des altérités. Nombre de gens en ont l’expérience et promeuvent, dans leurs idées et leurs pratiques, la coopération et le plaisir de faire et d’être avec les autres. Le voulons-nous aussi ? Une partie significative des gens qui ont revêtu un gilet jaune font actuellement et depuis plusieurs semaines, en dehors de leurs heures de travail, l’expérience de la discussion et de la coopération sur bien des questions qui nous concernent tous.
La grande concertation qui est annoncée débouchera-t-elle sur quelque chose d’inventif et de constructif ? Saura-t-elle opérer comme ensemble d’espaces articulés de conciliation entre le désiré, le tout à fait souhaitable et le possible ? Peut-être les circonstances actuelles méritent d’être saisies et d’offrir la rare occasion d’expérimenter de nouvelles formes de démocratie participative venant compléter la démocratie représentative et lui redonner de la légitimité. C’est pourquoi, si on le voulait, il pourrait être fait appel, par exemple, à des associations et à des personnes tierces, capables de garantir l’installation et la conduite de tels espaces d’échanges et de travail.
Valeur-travail ou travail et travailleurs dévalorisés ?
Depuis son investiture, Emmanuel Macron a fait adopter des lois qui laissent au capitalisme financier, à ses dirigeants et agents, l’initiative de s’enrichir toujours plus en faisant seulement « fructifier l’argent », y compris en ne désapprouvant pas l’évasion fiscale, qu’il préfère appeler optimisation fiscale, cette évasion n’étant pas illégale. Ce qui veut dire qu’un individu ou une organisation, qui font du profit en France, peuvent, en toute légalité nationale et internationale, ne pas payer leur dû en impôt sur le territoire où ils ont engrangé des bénéfices plus ou moins substantiels.
Fraudes caractérisées et évitement légal de l’impôt font perdre beaucoup d’argent à nombre d’États. Du coup, le budget national ne peut être équilibré. Aussi, la puissance publique est-elle contrainte d’emprunter et d’exiger plus de ceux qui ne peuvent ni frauder ni optimiser et qu’elle peut contraindre. Certes, un président de la République n’est pas le responsable, ni des évasions, ni des fraudes fiscales. De quel pouvoir dispose un État, des États lorsqu’ils veulent mettre fin à ces trafics ? Il faudrait, bien entendu, décider d’une harmonisation des fiscalités et du droit du travail entre tous les pays, ceux de la Communauté européenne au moins, pour commencer. Quand une liste transnationale aux élections européennes se donnera-t-elle un tel projet politique et le présentera aux électeurs ? Quand une loi sera-t-elle adoptée, dans toute l’Europe pour commencer, selon laquelle tout bénéfice réalisé dans un pays devra donner lieu à règlement de l’impôt dans ce même pays ?
C’est ainsi qu’est induite une augmentation des écarts de ressources entre les différentes couches sociales et économiques. Cependant, ne sont pas simultanément stimulés la création et le développement d’activités socialement, économiquement autant qu’écologiquement utiles et nécessaires, alors que celles-ci offriraient la possibilité aux plus jeunes, comme aux plus âgés, d’exercer un métier et de gagner décemment leur vie, tout en pensant au devenir de notre planète et à l’avenir des générations suivantes.
En outre, il faut souligner qu’Emmanuel Macron a affirmé haut et fort qu’il allait réussir, là où tous ses prédécesseurs n’auraient rien fait ou ont, ou aurait échoué. Répétant régulièrement cette affirmation erronée, les médias eux-mêmes amplifient le discrédit de la classe politique dans sa globalité. En cela, Emmanuel Macron ne dépareille pas de ses prédécesseurs qui ont tous tenu des propos peu ou prou équivalents. Il ne faut donc pas s’étonner du discrédit dont sont l’objet les élus successifs, dès les lendemains de leur élection, puisqu’en définitive, ils se montrent semblables dans leurs annonces ainsi qu’également dépourvus du pouvoir d’agir et d’initier des politiques publiques plus justes ou n’augmentant pas les inégalités ou les écarts entre les destins socio-économiques.
En effet, depuis des décennies, les politiques publiques promettent toutes une embellie à venir, à condition de commencer par une réduction du coût du travail et des retraites. Depuis des décennies, il est ainsi demandé à celles et ceux qui n’ont – ou n’ont eu — que leur « force de travail à vendre » pour gagner leur pain quotidien, quels que soient leurs métiers, d’y consentir. Ce type d’argument dévalorise le travail et donc les travailleurs. Les travailleurs sont ainsi désignés pour les différentier de leurs contemporains dont les revenus proviennent, en plus ou moins grande partie, de leur patrimoine, lequel, sauf exception, ne provient pas de leur propre travail, mais d’un patrimoine transmis et acquis par les générations précédentes dont ils sont issus.
C’est pourquoi l’argument de la diminution du coût du travail ne peut guère servir plus d’une fois. Or, à quelques nuances près, il a déjà été utilisé par nombre de gouvernements. Les uns et les autres se répètent. C’est tout à fait incohérent dès lors que l’on prétend vouloir restaurer la « valeur-travail », alors que, parallèlement, l’on réduit le salariat à une variable d’ajustement pour amadouer l’ogre-capitaliste-financier et ne pas s’attirer son courroux via, par exemple, les agences de notation, dont bizarrement, on n’entend plus parler.
La fascination de l’expansion illimitée de la croissance
En divinisant la croissance ou en la déclarant nécessaire au retour au quasi plein emploi comme à de meilleurs salaires, nombre de dirigeants se mentent à eux-mêmes et mentent à leur électorat et plus largement à tous les citoyens de leurs pays. C’est que nombre de ces dirigeants semblent y croire vraiment, dès lors qu’ils se laissent diriger de l’intérieur par un fantasme infantile qu’en principe, on identifie en grandissant, et dont on se libère alors. Ce fantasme infantile consiste à confondre la planète Terre avec la mère des premiers jours, et des premiers mois, en concevant subjectivement le corps de la mère et son sein comme inépuisables et éternels, c’est-à-dire dans lesquels on peut puiser indéfiniment puisqu’ils ne pourraient jamais tarir. Or, la planète Terre est un ensemble fini. Nous avons à accepter la réalité de l’existence de ces limites en renonçant à cette illusion que nous allons être sauvés grâce à son inépuisabilité et à l’expansion illimitée de la croissance, pour reprendre une alerte que nous a adressée, il y a 30 ans, Cornelius Castoriadis.
Il y a manifestement un problème, puisque depuis plusieurs décennies, des décisions politiques sont prises pour diminuer le coût du travail pour les entreprises et pour diminuer les charges des administrations publiques. Or, aucune de ces décisions ne semble avoir eu une efficacité suffisante, puisque chaque gouvernement, l’un après l’autre, se dit contraint de prendre à son tour de nouvelles mesures de réduction. Si aucune politique n’a été efficace, il doit y avoir des raisons qui mériteraient d’être analysées et comprises. La croissance ne revenant pas, le déficit public ne diminuant pas, ces annonces à répétition ne peuvent que discréditer l’action publique, les instances chargées de la conduire, ainsi que les élus qui les animent quelle que soit leur bonne volonté.
Le samedi 8 décembre 2018, deux manifestations emblématiques ont eu lieu. L’une était organisée pour alerter sur les catastrophes climatiques que le modèle actuel de développement prépare obstinément et afin que soient adoptées de nouvelles politiques publiques de développement durable, à l’échelon international et dans chaque pays. L’autre était initiée pour protester contre les mesures qui accentuent les inégalités et les injustices. Par certaines de ses revendications, elle pouvait apparaître en antagonisme radical avec une nouvelle politique, en tant qu’impératif désormais catégorique et urgent, qui imposerait un renoncement collectif à l’expansion illimitée de la croissance.
Emmanuel Macron a perdu là une belle occasion de démontrer qu’il n’était pas un illusionniste et son gouvernement avec lui. Il aurait pu montrer, sa volonté du « en même temps » qui l’a animé. Il aurait pu promouvoir, s’il l’avait cherchée et trouvée, dans et par la concertation, une politique publique qui concilie la réduction des inégalités de destin économique et la préservation de l’écosystème qui nous est nécessaire pour de pas hâter précipitamment la mise en extinction de la vie humaine sur la Terre. Reconnaissons que ce changement radical de politique de développement ne peut être l’affaire d’un seul être humain. Le présidentialisme n’est sans doute pas un régime adapté au monde actuel. Remplacer un président par un autre ne résout rien.
Cependant, les classes ou couches sociales « laborieuses » comme on les nommait autrefois, constatent que c’est à elles qu’on fait essentiellement appel pour payer la facture d’une nouvelle politique qui dit vouloir tenir compte de notre écosystème terrestre. Or, et par exemple, tout le monde ne paye pas les taxes sur les carburants, notamment les secteurs qui en consomment le plus. En outre, nous savons que le tout diesel a été encouragé depuis longtemps par les compagnies pétrolières, les constructeurs automobiles et les pouvoirs publics, alors que l’on savait très bien déjà, depuis longtemps, quel était l’impact-carbone de ce carburant. Ce devrait être les différents auteurs et acteurs publics et privés de cette incitation au Diesel qui devraient payer.
La révélation des violences invisibles
Nous sommes là confrontés à une expression de la violence systémique et légitime d’État, violence habituellement non visible. Or, en certains moments du processus historique, dont on ne peut écrire l’histoire qu’un certain temps après-coup, cette violence légitime d’État, cesse de l’être, précisément parce que celles et ceux qui sont aux responsabilités publiques, ne parviennent pas à concevoir les politiques qui surmontent des contraintes contradictoires et trouvent des voies pour les articuler constructivement, au moins en partie.
La violence symbolique d’un peuple, quoique fragmenté, s’est manifestée en se plaçant aux carrefours des circulations entre les mondes, afin de se rendre bien visible. À cette fin, une multitude de gens ont inventé une nouvelle manière de sortir des oubliettes, où ils ont été assignés, en se revêtant d’un gilet jaune ; ce gilet se porte de nuit lorsque l’on a une panne ou un accident sur la route pour ne pas être écrasé dans l’obscurité. Comme la violence symbolique n’est pas toujours perçue à sa juste signification, certains ont cru nécessaire de se faire casseurs. La violence brute associée à la violence symbolique sont venues révéler en miroir la violence d’État, violence légitime. Toutefois, lorsque certaines violences brutes adviennent, c’est que la violence légitime d’État a cessé d’être vécue et conçue comme légitime. C’est ce que nous vivons en cette période et les élus, les maires notamment, l’ont bien compris.
Dans un tel moment, un pays court bien des dangers.
En effet, même lorsqu’elle est prônée et pratiquée pour faire avancer l’Histoire dans le bon sens, la violence brute aboutit presque toujours au pire. Les regards sur le passé, les savoirs d’expérience des individus que nous sommes et les travaux des historiens l’ont bien établi. C’est pourquoi, il est hautement préférable de ne pas en arriver là. Toutefois, l’expérience nous a aussi enseignés qu’individus et groupes porteurs de requêtes, de revendications, de protestations, de propositions, qui choisissent délibérément les voies de l’argumentation et de la non-violence, ont très peu de chance d’être écoutées et réellement prises en compte. La plupart du temps, les dirigeants font la sourde oreille, tant qu’il n’y a pas de violence brute. Ils portent donc la responsabilité des révoltes violentes. Si au départ, il peut arriver que de bonnes personnes prennent le risque de la violence brute, ou sont poussées à ces extrêmes du fait de circonstances particulières, elles se retrouvent toujours très vite récusées ou supprimées, elles disparaissent et sont vite remplacées par des tyrans, sinon des exterminateurs, et leurs seconds couteaux. C’est pourquoi, pour refuser une politique de développement il est nécessaire d’être inventif et de trouver des formes de manifestation qui interrompent le fonctionnement sans destruction. L’interruption du train-train quotidien a déjà un coût élevé pour tout le monde. Détruire et porter atteinte à l’intégrité physique et psychique des individus n’est ni nécessaire, ni acceptable.
Les tyrans, qui rêvent d’asservir et de puissance, n’hésitent jamais à se draper dans des habits bien trop blancs pour être honnêtes. Il s’agit pour eux de dissimuler leur désir de confiscation complète des pouvoirs politiques propres aux démocraties modernes, tout en faisant croire qu’ils sont porteurs des intérêts des peuples, alors que l’invocation de ces intérêts n’est qu’un masque pour manipuler les espérances. La démocratie moderne suppose la prise en compte des contradictions et non leur déni. La démocratie moderne est incompatible avec la domination d’une partie majoritaire ou minoritaire d’un peuple ou corps social aux dépens d’une autre.
Dans la situation française actuelle, on croit comprendre que parmi les groupes qui se rangent derrière le nom « Les Gilets Jaunes », il y a bien des positions différentes, et les plus extrémistes d’entre eux n’ont pas attendu pour exprimer des haines ou des désignations comme traitres, voire des appels au meurtre, à l’encontre de ceux qui ne pensent pas exactement comme eux.
On entend dans les médias que les « Gilets Jaunes » ne veulent pas nommer de représentants et ne veulent surtout pas employer le mot négociation. Ce qui veut dire qu’ils ne veulent pas entrer dans des rapports de négociation, c’est-à-dire aussi dans une conflictualité dynamique et constructive pouvant aboutir à des compromis. Sans doute redoutent-ils de « se faire avoir » par une participation au jeu social et politique de la négociation. La négociation est pour eux comme une reddition. Mais, n’en est-il pas de même du côté du pouvoir d’État ?
Doit-on comprendre que ce qui est exigé par des « Gilets Jaunes » correspond à une demande de reddition complète, corps et âmes, des élus qui siègent dans les différentes institutions publiques ? Dès lors pourquoi réclamer la démission du président de la république ou des élections nouvelles, si l’on suspecte le système électif d’être lui-même générateur d’abandon du souci du peuple que l’on prétend représenter ? La reddition obtenue des élus en place ne serait pas préférable pour les « Gilets Jaunes » ? Puisqu’ensuite ces élus n’auraient plus qu’à s’exécuter en adoptant toutes les dispositions de politique publique appelées de leurs vœux par les « Gilets Jaunes ». Évidemment, un pays ne peut fonctionner avec un tel système de pouvoir.
Cette reddition exigée par les « Gilets Jaunes » est une figure des rapports sociaux qui est exactement la réplique, en symétrie, en miroir, de ce qu’exige, de tous, le président actuel de la République française depuis son élection. Il a comme reconcentré tous les pouvoirs principaux. Un seul exemple : en décidant de la suppression de la taxe d’habitation, ce président a enlevé pratiquement et symboliquement aux maires le droit et le pouvoir de lever l’impôt, et a restreint les marges de décision des politiques municipales. Ceci advient alors qu’ont été ajoutées de nouvelles responsabilités aux maires, depuis des années. S’il ne l’a pas décrété lui-même, d’autres l’ont fait avant lui. Il en est l’héritier. Il ne leur reste plus qu’à démissionner.
Le mépris des corps intermédiaires
Il n’y a pas que les maires qui ont été ignorés. L’ensemble des corps intermédiaires aussi, dont les syndicats et les associations qui œuvrent avec patience pour entretenir et nourrir les liens entre les individus, par la médiation d’activités et d’engagements diversifiés et émancipateurs, dont l’apprentissage de la citoyenneté. Or, depuis le basculement des majorités dans nombre de collectivités locales et territoriales, les premières décisions prises par les nouvelles majorités ont été de réduire ou de supprimer des financements qui contribuent pourtant au développement culturel sous différentes formes et aux liens associatifs et sociaux.
La négociation, qu’est-ce que c’est ?
Négocier, c’est reconnaître l’autre comme partenaire, c’est accepter la légitimité de son existence, de ses idées, de ses arguments, de son pouvoir de proposition, c’est accepter l’existence de contraintes, des contraires, ou de désirs contradictoires, et même d’antagonismes, non nécessairement radicaux, dans la société, ce qui permet de reconnaître autrui et d’être reconnu de lui et de chercher à concilier des éléments qui s’opposent plutôt qu’à amplifier leurs dimensions antagoniques.
La complexification continue du monde et l’interdépendance qui se généralise entre ses différents territoires créent beaucoup d’incertitude et fabriquent bien des inconnues, rendant l’avenir imprévisible. Cette imprévisibilité réveille chez bon nombre des angoisses et des fantasmes que l’on appelle archaïques, c’est-à-dire comparables à ceux qui pouvaient être confusément éprouvés par nos lointains ancêtres confrontés à un environnement totalement inconnu. Le monde n’était qu’énigme, car ils vivaient bien avant l’émergence et le développement des connaissances scientifiques. Ces angoisses et fantasmes rendent quelques-uns d’entre nous disponibles pour accorder crédit à des bonimenteurs habiles à manipuler le besoin d’illusion du tout petit enfant qui persiste en l’adulte qui reste apeuré, envahi, sinon commandé de l’intérieur par des angoisses archaïques, devant l’inconnu, d’autant plus qu’il est laissé seul.
Les hâbleurs démagogues, qui ne peuvent conduire qu’au pire, trouvent des électeurs et donc des âmes manipulables disponibles pour faire semblant de les croire et de voter pour eux.
D’où vient cette aspiration au pire pour tous et pour l’humanité entière ?
Ceux qui sont plus malmenés que d’autres par la vie, parce qu’ils n’ont pas accès à des lieux de rencontres et de paroles échangées avec d’autres qui leur permettraient de faire quelques pas de côté vers une certaine compréhension du monde, prenant en compte sa multiplicité et sa complexité, peuvent se laisser aspirer par la spirale du pire, en précipitant le monde entier dans un gouffre. C’est une façon de se faire justice. En effet, au fond de sa psyché, un être humain peut être tenté par le raisonnement terrifiant selon lequel puisque le meilleur n’est pas possible pour moi, créons le chaos et la mortification pour tous.
Nous savons très bien où mènent ces pulsions destructrices, elles font le lit des régimes autoritaires, voire totalitaires.
C’est pourquoi, il n’est pas de politique publique plus urgente que celle fondée sur un travail patient de pensée pour comprendre ce qui a conduit une partie de la population dans une dépressivité massive, avec son versant de violences qui peut provoquer des désirs d’en finir avec la vie, rendre malades, ou qui peut lever les interdits fondamentaux et libérer des pulsions meurtrières et pousser vers l’adhésion à des mouvements ou à des politiques qui, en définitive, ne sont animés que par de la destructivité, tournée contre soi ou contre les autres, ou la culture, ou les trois, ou encore contre notre écosystème qui, détruit, décidera pour nous.
C’est pourquoi, il nous faut travailler à changer notre représentation infantile de l’inépuisabilité de la planète Terre, en commençant notamment par revisiter notre conception de l’éducation tant en famille qu’à l’école. Nous avons à modifier nos représentations des rôles de professeur, d’éducateur, de parent, en développant en nous notre capacité de sollicitude et de transmission de celle-ci, afin que chaque enfant en ait l’expérience collective et la ressente et forge en lui sa sensibilité à lui-même et à autrui et comprenne que, malgré les difficultés, la vie vaut la peine d’être vécue avec les autres et non pas sans les autres et contre les autres. Pour cela, il faut commencer par arrêter de se laisser séduire par les chants des sirènes actuelles qui, par exemple, ne cessent de nous abreuver de déclarations nous annonçant que, bientôt, nous disposerons de robots à intelligences artificielles démultipliées qui sauront résoudre mieux que nos esprits limités les problèmes du monde. Bref, c’est comme s’il nous était promis et annoncé que, grâce à l’intelligence appelée artificielle, « on » n’aura plus besoin de nous puisque nous pourrons bientôt être remplacés par des robots. Voilà l’avenir que l’on dessine devant nous depuis des semaines et des mois.
Une telle prophétie relève-t-elle d’un esprit scientifique éclairé ou de l’exercice d’une violence d’État, à l’insu de ceux qui l’exercent, ce qui ne les exonère pas de leur responsabilité, puisqu’elle annule le sacré – au sens non mystique du terme — de l’existence humaine et qu’elle renvoie chaque individu à une angoisse que j’ai nommée angoisse socio-existentielle d’insignifiance sociale, ce qui peut pousser à l’aspiration au pire pour tous, c’est-à-dire au néant.
Non à l’Homo statisticus ou numéricus virtuel et fictif, non à l’individu-masse monocolore. Développons l’intelligence humaine individuelle et collective, dans des pratiques partagées et des environnements stimulants et sollicitants ; à cette fin, intéressons-nous davantage encore à chaque être humain réel et singulier, en particulier avant et après sa naissance et pendant toute sa longue phase de travail psychique et culturel pour grandir.
Nous allons tous être invités à participer à une grande consultation et à exprimer des propositions à l’adresse des instances dirigeantes. Que sommes-nous capables de dire, de conseiller ? Commençons d’abord à en parler à plusieurs ici et là.
L’Appartenance Pour une École qui soit organisée comme groupe ou communauté réelle d’appartenance de base.
Dès l’enfance, pour se ressentir être humain, l’individu a besoin d’éprouver son appartenance à un groupe. Si cette expérience de l’appartenance lui est donnée à vivre, c’est que ce groupe fait société[1], ce qui, notamment, naît de la rencontre avec des prédécesseurs qui font figures d’identification valorisées par le groupe, ce qui stimule l’aspiration à grandir et à prendre place parmi les autres.
Dans le monde contemporain, pendant la bien longue période du passage adolescent ou du travail psychique de grandir, le groupe d’appartenance offre à l’individu un environnement où il peut se reconnaître dans les autres et se sentir reconnu. Ainsi, la quête de reconnaissance de chacun trouve du répondant qui soutient le sentiment de la réalité de l’existence : l’individu ne reste pas au bord de l’effroi du vide et de l’abîme des angoisses primaires.
Le premier groupe d’appartenance est la famille, sous condition qu’elle soit affiliée à un ensemble social plus vaste. Le deuxième groupe social de base est l’École. Ici, le concept d’École représente l’ensemble des structures de socialisation et d’apprentissages, scolaires et socio-éducatives, dans et hors de l’École où des aînés, des adultes, des prédécesseurs sont là. Ces structures médiatisent la société dans son ensemble auprès des plus jeunes. Leur mission est de prendre soin des enfants des nouvelles générations pour les aider à grandir. À cette fin, ils se font les intermédiaires entre le patrimoine culturel collectif et les enfants. Par des mises en activités et nombre de pratiques culturelles, tant individuelles que collectives, ils initient les plus jeunes. Au cours de ces activités, les plus jeunes sont avec des aînés et des pairs avec lesquels ils pratiquent et découvrent le plaisir de faire, d’apprendre et de réussir à fabriquer et à utiliser des objets, tout en développant de nouvelles habiletés dans des rapports de transmission et d’entraide.
Par définition, un groupe d’appartenance fait fonction de communauté pour ses membres. Soulignons que l’on abuse du terme de communauté éducative dans le monde de l’éducation, ce qui discrédite les paroles des grands. En effet, le terme de communauté désigne une formation sociale dont les éléments sont liés par ce qui fonde leur « en-commun », c’est-à-dire par ce qu’ils ont et font en commun ; pour ce faire, ils disposent d’un territoire propre où les membres font ce qu’ils ont à faire ; en France, ce territoire de l’éducation est généralement confié par les institutions publiques qui résultent de conventions antérieures du fait de l’histoire collective. Le groupe d’appartenance est éprouvé lorsqu’il y a, pour chacun, la possibilité et l’envie de dire « nous », sans exclure, et que chacun est fier de dire « nous », et pas obligé de dire « nous » ; le sentiment d’appartenance n’est éprouvé que si l’individu sent confusément qu’il a sa place et si son angoisse socio-existentielle — ou ontologique —d’insignifiance sociale se trouve comme enchâssée dans son expérience sociale réelle, ce qui lui procure le sentiment indispensable d’être utile et d’exister et de compter pour les autres.
Cet éprouvé de la réalité de l’appartenance et du groupe d’appartenance n’advient que si sont créées les institutions suscitant de fortes interactions quotidiennes entre les membres. Ces interactions se produisent par des modalités de travail sollicitantes et un fonctionnement social approprié. Sans ce fonctionnement concret comme communauté d’appartenance, l’École ne peut remplir ses missions ; quand il en est ainsi, elle abandonne les enfants car elle les laisse seuls aux prises avec d’autres appels à faire groupe. Pourtant, nombre de ces autres appels sont comme les chants des sirènes évoqués dans les contes et légendes qu’on lit ou lisait aux enfants. Non encadrés par des rituels comme dans le cadre des sociétés antérieures de culture traditionnelle, ces groupes, dits de pairs, sont en fait des groupes « contre », des groupes qui excitent la dynamique pulsionnelle de l’adolescence excitée par la tentation de l’extrême. Que ces groupes existent est inévitable. Mais qu’ils soient les seuls à se constituer comme « groupe-attracteur » montre que ceux qui ont mission de prendre les décisions en matière de politique publique d’éducation ne prennent pas en compte certains acquis du savoir, ce qui les empêche de se mettre en position de penser.
Or, ces groupes sont des « groupes-contre », du fait de l’envie destructive de l’obscur objet du désir auquel on n’a pas accès, qui pousse à vouloir avoir ce que l’on ne peut pas être. Mais, être et avoir ne sont pas équivalents. Trouvant leur moteur dans la haine de l’objet, de l’autre et de soi, ces pseudo-groupes « contre » sont donc à la fois contre soi-même et contre la société. Par leurs discours ou absence apparent de discours, ils entrent en résonance avec deux des caractéristiques de base de la problématique adolescente. En effet, on y trouve, d’une part, le besoin de s’opposer à l’autorité des parents, des adultes ou à l’ensemble des prédécesseurs — ceux-ci étant vécus comme des empêcheurs d’être et de vivre, des humiliateurs, d’où l’utilisation fréquente et manipulatoire de l’imaginaire leurrant de la thématique des frères ou du groupe des égaux. Cette thématique repose sur le déni de la différence des générations et d’autres dénis de réalité. Elle développe une auto-idéalisation aveuglante de soi et des faux-frères qui fournit à leurs membres le sentiment illusoire qu’ils se sont libérés de toute tutelle, de toute emprise — d’autre part, l’attrait pour la perfection, la pureté, l’entièreté, l’extrême, ce qui correspond à une construction défensive contre l’angoisse socio-existentielle d’insignifiance sociale et l’angoisse de ne rien valoir du tout. Et, comme le meilleur, le parfait, le pur ne sont du domaine de possible, on peut se retrouver aisément manipulable et disponible pour l’extrême opposé et se laisser choir dans l’attrait pour le pire, l’extrêmement pire étant lui possible. On le sait avec les totalitarismes du 20e siècle.
C’est pourquoi, il est impératif de modifier les formes sociales d’organisation de l’École qui font appel au discours sans correspondance cohérente avec les pratiques. Sans ce changement radical, qu’il est urgent de promouvoir à l’École, eu égard aux désorganisations familiales contemporaines aux facteurs multiples, qui résultent notamment du fait que toutes les familles ne font pas groupe d’appartenance, parce qu’elles ne sont pas elles-mêmes affiliées à un groupe social et culturel d’appartenance plus large, nombre de jeunes, rattachés à rien, se trouvent dans des impasses psychiques et sociales. C’est pourquoi ils sont disponibles pour écouter les « Joueurs de flûtes » hypermodernes qui leur promettent l’apothéose dans la mort en entraînant des destructions massives à la dimension de l’immensité de leurs angoisses archaïques et de leurs souffrances associées tout aussi démesurées. La mort est une délivrance.
C’est ainsi que nombre de jeunes ou de moins jeunes, privés de l’environnement adéquat pour grandir, forment des proies pour ces joueurs de flûtes, ou sirènes de notre époque, qui leur proposent un pseudo-groupe d’appartenance, exclusif et excluant où, finalement, il n’y a de place pour personne, puisque la seule porte de sortie est la mort.
Une Refondation de l’École de la République qui ne prend pas en compte ces données de réalité fort complexes, ici succinctement exposées, est une chimère, une preuve d’ignorance, à moins que ce ne soit par méconnaissance et absence de compréhension de ce que veut dire le sens de la responsabilité éducative.
Comment t’appelles-tu « Charlie » ?
Comment t’appelles-tu Charlie ?
Le 7 janvier 2017
Un enfant forge son humanité quand il bénéficie d’un environnement humain, c’est-à-dire attentif et intéressé à découvrir en lui le nouvel être humain en devenir qu’il est, porteur d’un projet original et constructif qu’il aura à chercher-trouver au fond de lui, puis à déployer en s’étayant sur la sollicitude éducative de ses premiers entourages. Le premier milieu de vie est sa famille ou la structure qui supplée à celle-ci, le cas échéant et en tout ou partie, encore faut-il que ce groupe familial ou social soit lui-même activement affilié à une société et forme avec elle un univers d’appartenance structurant. Constitué de prédécesseurs dotés de la capacité de sollicitude, cet environnement-là est celui qui permet à un enfant de grandir et de vivre avec d’autres l’expérience de cinq capacités majeures qu’il pourra intérioriser au cours de « son travail de grandir ».
Ces cinq capacités sont :
la capacité d’être sensible à la souffrance d’autrui ;
celle de reconnaître l’autre comme un semblable et un différent à la fois qui fait que l’on est capable de supporter tant la compagnie du semblable en l’autre que celle du différent ;
celle de participer à des controverses par lesquelles l’enfant se confronte et apprend en même temps à se confronter à l’altérité qui permet de sortir de l’immobilité psychique et culturelle et d‘un destin mortifiant ;
la réciprocité, par laquelle il apprend à accorder à autrui un égal accès aux droits et devoirs fondamentaux que ceux qu’il s‘accorde à lui-même ; cette capacité suppose un renoncement tant à la logique mortifère de la succession interrompue de fureurs, de violences et de crimes, de génération en génération qu’à la revendication d’un statut d’exception pour soi ;
enfin, l’accès à une conception et une pratique de la liberté individuelle toute différente que celle qui a le plus souvent cours ; l’individu y a accès avec bonheur quand il comprend que la seule liberté individuelle réelle qui puisse exister n’augmente que quand la liberté de l’autre augmente aussi.
Un mercredi de janvier 2015, je franchissais lentement les portes successives d’un collège pour en sortir. Quand, dans le même interstice, je me trouve tout proche, presque nez à nez avec trois élèves aux visages poupons. L’un d’eux, plus grand que moi, me dit : « Tu es Charlie ». Je vois trois paires d’yeux me scruter : que devais-je entendre ou privilégier : tuer Charlie, tu hais Charlie ou tu es Charlie ? Surpris de leur interpellation, je leur réponds aussitôt : « Je m’appelle André ». Alors, tous trois se détendent et me disent immédiatement l’un après l’autre leur prénom tout en me souriant d’une façon que j’ai ressenti comme affectueuse : Ils commencent par me dire : « Tu es André » puis, me dit l’un : « Moi, je m’appelle Abderrahmane », un autre : « Moi, je m’appelle Farid », le troisième : « Moi, je m’appelle Aldelhaoued ». Puis, nous nous sommes salués pour nous dire au revoir, ils avaient l’air heureux. Je sortais alors du collège Aimé Césaire à Paris 18e, où venait d’être accueillie une réunion du conseil national de l’innovation pour la réussite éducative (CNIRÉ), dont je suis membre au titre du collectif des associations partenaires de l’École publique (CAPE), quelques jours après le 7 et le 11 janvier 2015.
En chaque instant de la vie, du fait des résonances entre ses réalités psychiques et les réalités environnementales des mondes externes, l’être humain est renvoyé à des tensions énigmatiques dont le sens lui échappe, aussi ne peut-il les réguler. S’il s’efforce de s’en délivrer en parlant, analysant puis en élaborant ce qu’il ressent confusément, il parviendra à comprendre pourquoi advient ce qui se passe en lui. En parlant avec d’autres, au lieu de s’en intoxiquer par des accumulations successives de non-dits et d’impensés, il peut intégrer chaque nouvelle expérience à sa vie sociale, relationnelle et psychique en augmentant son territoire psychique intérieur, ce qui lui ouvrira un accès aux territoires extérieurs à partager en entrant en immédiate relation, sans défensivité excessive, avec les autres réels et non avec un autre imaginaire dont il recherche vainement la protection ou la reconnaissance, ou la caractéristique par laquelle il se sentira annulé ou humilié.
Pour quelques temps, « Charlie » a été pour beaucoup un synonyme d’être humain. Ne les oublions pas. Faisons durer ces quelques temps.
____________________________
____________________________
Quelques principes et analyses pour une formation des futurs professeurs
Les changements en cours dans la formation et les calendriers de recrutement des futurs professeurs des écoles, collèges et lycées, suscitent de nombreuses critiques qui, pour les deux principales, sont antagoniques ; d’un côté se regroupent ceux qui estiment assister au renoncement programmé aux savoirs ou disciplines enseignés à l’école, tout en déclarant très secondaire sinon inutile toute formation non disciplinaire et même les stages, pendant que d’autres soulignent, entre autre, qu’au delà de la formation disciplinaire, bien entendu incontournable, ces changements organisent le renoncement à une préparation sérieuse au travail réel des enseignants.

Les nouvelles dispositions annoncées s’avèreront globalement vaines eu égard à leur inadaptation au travail réel et aux défis à relever, car les réalités des métiers de l’éducation et de l’enseignement ne sont pas prises en compte. On est donc fondé de penser que ceux qui décident ont décidé de refuser de prendre connaissance de ce qui est.
Nous ne revenons pas ici sur l’éventail des critiques et leurs différences. Il est annoncé que tout y sera : « c’est un fourre-tout » disent quelques uns. Ce n’est nullement le cas. Certes beaucoup est inclus. Mais l’essentiel n’y est pas. Nous ne proposons pas de remplir davantage ce « fourre-tout ». Pour initier à l’un des métiers de l’éducation, des dispositifs de formation entièrement nouveaux doivent être conçus et réellement répartis en formation initiale et en formation continue. Sursaturer le modèle précédent ne peut que former plus mal. Nous disons non à la politique de l’autruche.
Dans le cadre de cette rubrique « Urgence », nous réaffirmons quelques analyses et principes sur lesquels pourrait être construite une nouvelle école adaptée à l’époque actuelle[1].
Appuyé sur l’expérience et le patrimoine de l’éducation nouvelle, nous préconisons une école qui crée les conditions possibles pour l’éducation et l’acquisition des savoirs, dont des savoirs concrets qui permettent de prendre en charge sa vie quotidienne et des savoirs intervenir par la parole dans la vie de la cité où l’on vit, à commencer par l’École.
L’École et la Famille sont les deux groupes sociaux de socialisation et d’éducation de base des nouvelles générations. En effet, pour concevoir un enfant et l’élever, un père et une mère ne suffisent pas, il faut aussi une société qui s’engage et qui organise ces liens entre l’École et la Famille.
Rappelons cette évidence, que bien du monde passe sous silence : l’école est un groupe, une classe est un groupe. Pourtant la sensibilisation sinon la formation aux réalités des processus collectifs n’est pas au programme des formations. Quand la question du groupe est dans un programme, les formations proposées sont la plupart du temps seulement théoriques ou assurées par des formateurs très insuffisamment formés pour cela. La formation psychosociologique à la vie des groupes et à ce qu’on donne à voir de soi aux autres dans un groupe et à son insu n’existe pas. Or, elle est indispensable. Le professeur n’est donc pas préparé à entrer dans une classe, un groupe-classe et n’a qu’une idée bien partielle et donc bien fausse de ce que le système de l’éducation nationale provoque avec sa complicité passive en regroupant des jeunes qu’il assoit les uns à côté des autres des heures durant et à longueur d’années.
En outre, pour pouvoir être et se situer dans un groupe, une organisation, s’adresser à d’autres, et s’investir dans son travail, il est nécessaire d’être assigné à une place instituée donnant une existence sociale et nourrissant le sentiment de la continuité de l’existence entre les générations. C’est ce qui permet de se sentir compter pour les autres, pour la société. Sans instances instituées à l’école pour créer un système de places sociales pour les différents acteurs du système scolaire, le travail de transmission des professeurs et cadres de l’école et d’affiliation des nouvelles générations à ce qui est déjà là avant elles ne peut être entrepris de façon satisfaisante.
Toute procédure ponctuelle d’éducation à la citoyenneté est artificielle, si des instances d’exercice concret et quotidien de cette citoyenneté ne sont pas conçues et actives.
L’école a pour mission d’accueillir tous les enfants d’âge scolaire. Pour remplir cette mission, il lui revient de créer pour eux les espaces et les médiations propices à leur mobilisation sur les tâches de l’école qui organise le travail de chacun de ses membres : les élèves, les professeurs, les cadres d’éducation et de direction, les autres intervenants d’autres professions contribuant aux missions de l’école et à son fonctionnement dans sa vie quotidienne.
L’école et ceux qui y travaillent accueillent des individus singuliers et non des catégories sociologiques ou des unités statistiques. L’élève-statistique abstrait n’existe pas. L’élève idéal-type n’existe pas, pas plus que le professeur idéal-type. Chaque individu suit un mouvement singulier, original, un rythme qui lui est propre, pour grandir et pour apprendre, pour transmettre. Ce qui fait que l’école est mise en demeure de créer, à chaque instant, un espace potentiel commun, pour que les chemins se croisent, pour que les individus singuliers se parlent, se rencontrent, pour que les univers logiques de chacun s’ouvrent un peu, sans crainte d’effondrement ou de disqualification, pour entendre les logiques, les chemins des autres.
On parle souvent de méthodes pédagogiques, de bonne ou de mauvaise méthode. Quand on prend un peu de recul, on comprend que toute méthode, sauf celles qui sont folles et faites pour rendre fou, peut être efficace, si elle est investie, c’est-à-dire si le maître est engagé, veut transmettre, mais pas immodérément, et s’il laisse pour cela une place aux élèves, une place pour le déploiement de leur propre désir d’apprendre qui peut parfois être entravé par des interdits d’apprendre qu’il est souhaitable de ne pas ignorer.
Un modèle de formation de futurs professeurs doit prendre aussi en compte ce qui peut s’apprendre en formation initiale et ce qui ne s’apprend qu’en formation continue. Si une sensibilisation avant la prise de fonction peut alerter les futurs professeurs, il est bien difficile pour eux, alors qu’ils sont mobilisés pour la réussite des concours ou des examens qui portent quasi exclusivement sur des épreuves de connaissance disciplinaire, de se représenter avec toutes leurs épaisseurs les dimensions du métier. Même si elles doivent faire l’objet d’une sensibilisation au cours de la formation initiale et à la faveur de stages supervisés par des professionnels qui savent ce que superviser veut dire et ne veut pas dire, ces dimensions et leur complexité peuvent être repérées et élaborées saisies utilement en formation continue. C’est pourquoi est nécessaire un dispositif d’accompagnement des nouveaux enseignant, qui implique un travail d ‘équipe intégré au temps de travail. Comme le travail d’équipe est une pratique sociale très largement inconnue, bien que souvent invoquée, une formation au travail d’équipe est un préalable, sous condition que ces formations soient assurées par des formateurs capables eux-mêmes de travail d’équipe, et sous condition d’y consacrer le temps approprié. Il faut du temps pour se former, et d’abord le temps de se déformer sans se casser.
Enfin parlons un peu d’autorité. On peut exercer de l’autorité et assurer un pouvoir délégué par une institution quand on comprend de quoi il s’agit, quand on a renoncé à des rapports de simple puissance, c’est-à-dire de domination. La structure d’autorité et les repères d’autorité dans une École ne tiennent ni des statuts ni des textes. Ils ne tiennent que des lieux et de la qualité des paroles échangées régulièrement dans des instances conçues et investies spécifiquement pour cela entre les adultes qui assument dans l’école l’un des métiers d’éducation et d’enseignement, et entre adultes et adultes en devenir. Chacun sait combien les qualités personnelles et les compétences à animer et conduire des groupes et des réunions de travail d’un chef d’établissement sont capitales et orientent le climat d’un établissement. Or, la formation que les chefs d’établissement reçoivent n’est pas adaptée à leurs fonctions réelles. Elle leur distille l’idéologie des rapports de puissance et non l’esprit des rapports d’autorité. Un bon chef d’établissement ne l’est que par ses exigences personnelles et non grâce à la formation obligatoire qu’il reçoit. Ajoutons et chacun le sait que les Écoles sont sous-équipées en matière d’équipes de direction et d’administration eu égard à la multiplicité des tâches qui leur reviennent, aux pressions qu’elles subissent, aux problèmes quotidiens multiples qu’elles ont à prendre en charge et à tenter de résoudre. À tout cela s’ajoutent chaque jour des injonctions désorganisatrices venant de hiérarchie et des sollicitations de celle-ci qui les appellent ailleurs que dans leur établissement. Tout cela pour dire que le système éducation Nationale avec ses changements perpétuels et ses pratiques est le premier facteur de désordre et de discontinuité du service public de l’éducation nationale. D’où le nombre des postes vacants, le nombre des congés de maladie pour des motifs sérieux, sinon très graves.
Bien sûr, une société qui honore sa mission d’éducation et d’enseignement, a une politique de prérecrutement et de pré-salaire pour encourager les jeunes générations à s’orienter vers le métier de professeur. Or, les responsables publics ont pris le chemin inverse depuis vingt cinq ans en supprimant d’abord les Écoles Normales, puis les allocations, puis l’année de formation professionnelle rémunérée. En supprimant les pré-salaires et les allocations, les pouvoirs publics ont organisé sciemment la destitution du corps enseignant comme constitutif de l’État républicain et de son corps social. En reculant l’âge d’entrée en fonction et en augmentant le nombre d’années de formation initiale, les pouvoirs publics font comme si on apprenait à être enseignant en situation sur les bancs de l’université, ce qui n’est pas le cas, car ce n’est tout simplement ni la mission de l’université, ni de sa compétence. Personne ne l’ignore pourtant.
Les militants de l’éducation nouvelle à l’école refuseront là où ils sont et comme ils le peuvent de participer à ce jeu de dupes. D’autant que des écoles où l’on fonctionne autrement existent, à l’intérieur même de l’éducation nationale, à l’initiative d’équipes engagées, leur réussite a été évaluée. Toutefois, soulignons que, curieusement, le ministère ne fait absolument rien pour que ces écoles soient connues, rien pour susciter de nouvelles bonnes volontés. Il ne peut y avoir de révolution scolaire que par une politique très élaborée et patiente de transformations en s’appuyant sur de nombreuses équipes d’enseignants qui existent et travaillent.
Pour une nouvelle politique scolaire, il faut renoncer à instrumentaliser l’école et la jeunesse en les mettant au service des échéances électorales. C’est pourquoi, pour une école nouvelle, républicaine et laïque, nous demandons que les ministres chargés de l’éducation et de la jeunesse soient indépendants des majorités provisoires qui, rappelons-le, sont toutes relatives.
Lorsqu’une réforme prendra en compte les analyses et principes, ici très schématiquement mentionnés, de nombreux volontaires se manifesteront. Et, il est malheureusement urgent que la classe politique sorte de son anesthésie et de sa fascination pour les unités fictives quantifiables qui ne renseignent en rien sur le réel, car malgré l’action et le dévouement invisible de nombre d’acteurs du système, chacun ici et là, dans les établissements scolaires, s’attend au surgissement d’une catastrophe, une sorte de Tchernobyl scolaire, tellement les structures scolaires et les instituions, les formations nécessaires ne sont pas pensées et donc pas en relation avec la réalité.
[1] – Nous développerons ces quelques principes pour une autre École dans un article à venir, mais les lecteurs intéressés peuvent lire ou relire : « Des clés pour réussir au collège et au lycée », ouvrage collectif coordonné par Françoise Rey & André Sirota, Toulouse, Érès, 2007 ; & « Violence à l’école. Des violences agies aux violences vécues », ouvrage collectif, sous la direction d’André Sirota, Paris, Éditions Bréal, 2009.
Qu’est-ce qu’un stage de formation ?
Extrait du Site officiel des Ceméa – Mouvement national d’éducation nouvelle
C’est en 1937, qu’avec Gisèle de Failly et Henri Laborde, ceux qui allaient créer l’association des CEMÉA en 1947, ont inventé les premiers stages de formation pour préparer les futurs moniteurs et cadres des colonies de vacances. Par une obligation que s’est donnée la société en 1936, les parents, partie prenante des classes laborieuses, venaient de bénéficier d’une période annuelle de congés payés. Jusque là inconnues, les vacances étaient alors instituées par la loi. Pour que les parents puissent en profiter tout en étant rassurés sur l’accueil de leurs enfants, il y a avait lieu d’imaginer parallèlement un modèle offrant aux enfants l’occasion de vivre dans un environnement collectif dépaysant et éducatif à la fois. À cette fin, former des cadres et moniteurs pour cette nouvelle responsabilité à concevoir ouvrait un nouvel espace du possible pour faire avancer les idées et les pratiques en éducation.
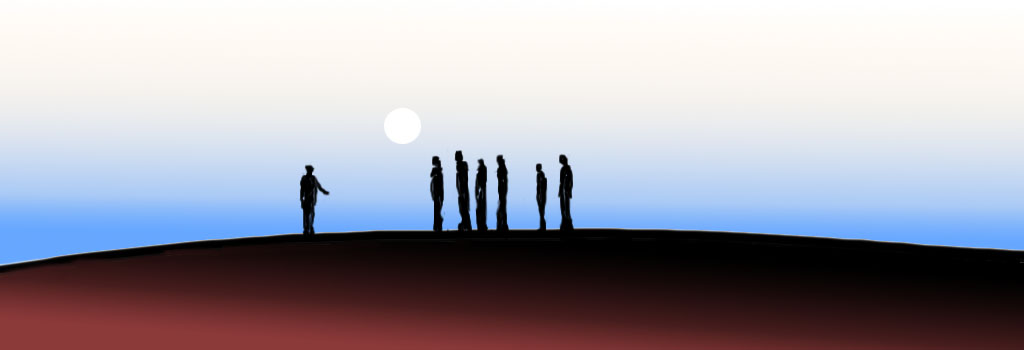
Les fondateurs des Ceméa étaient animés par l’esprit des Lumières et soutenus par le mythe du progrès, caractéristiques de la société moderne dont l’histoire était conçue comme un processus continu d’émancipation, grâce au développement des sciences éclairées par la raison et au développement de la raison éclairée par les sciences et leurs avancées progressives. Habités par les idées de l’éducation nouvelle et des méthodes actives, ils ont eu l’intuition de stages de formation intensifs et résidentiels d’une durée suffisante : dix à onze jours consécutifs. Au centre de gravité de l’éducationnouvelle, figurent quelques principes majeurs ; Tout en nous appuyant sur ces principes, tels que nous les a légués Gisèle de Failly (1957) , j’en rappelle ici quelques-uns seulement dans une nouvelle formulation ou extension. La reconnaissance de l’enfant comme une personne à part entière mais inachevée à la naissance, qui a donc besoin d’un entourage sécurisant et étayant, plein de sollicitude envers lui. L’enfant est porteur d’un projet intime, original et constructif qui se déploiera si les prédécesseurs prennent soin de concevoir l’environnement propice pour cela. Un désir de grandir, de s’élever le pousse, s’il n’est pas trop molesté. Ce travail de grandir passe par l’expérience personnelle en relation avec d’autres, d’où l’importance de l’aménagement du milieu dont le milieu social, relationnel ou éducatif pour en faire un espace intermédiaire à la fois rassurant et tremplin pour aller au-delà, donnant le courage d’aller se risquer vers l’inconnu sans prise de risque immodérée. D’où l’importance de l’invention de médiations multiples vers les apprentissages, diversifiant les portes d’entrée dans le monde qui rendent possible aux nouveaux venus de mobiliser et d’investir leur énergie. Ces médiations doivent être conçues de telle façon que chaque enfant, avec sa singularité propre, se sente attendu dans le monde, sans être entravé par un excès d’attention, sans être lâché dans le vide, et puisse aller vers les « objets » du monde extérieur, vers les autres, pour faire ses propres expériences, puis se trouve dans les conditions de les intérioriser psychiquement, ce qui suppose des lieux adaptés à son âge pour une prise de parole, pour analyser ses expériences et les penser en confrontant ses analyses avec celles d’autres enfants et des aînés. Telle est la démarche qui permet non seulement de vivre une expérience mais aussi de s’en enrichir intérieurement. Sinon, l’expérience ne se constitue pas comme telle. Elle passe aux pourtours de soi comme l’eau sur les plumes d’un canard. Ou bien l’être humain s’en intoxique, quand il laisse en lui comme un dépôt encombrant sa psyché, les traces d’une expérience non digérée et non liée, sinon traumatique, c’est-à-dire non conquise. L’engagement dans un stage n’est pas acquis Soulignons que les animateurs d’un stage de formation qui réfèrent leur action à l’éducation nouvelle sollicitent la participation de chacun aux différents moments de la vie quotidienne et pas seulement aux séquences et activités de formation. Eu égard à l’importance et à l’étendue des responsabilités à assumer dans des fonctions éducatives, en centre de vacances par exemple, un stage doit éveiller un intérêt, susciter un engagement dans la formation qui n’est pas acquis en début de stage, malgré les propos que l’on peut entendre lors de présentations. En effet, quand on va en formation, on est peu ou prou ambivalent. On peut aisément camper sur une position défensive face à tout ce qu’il y a à apprendre, à découvrir, à l’effort à fournir pour entrer en contact avec des « objets » de formation, avec une activité. On est plus ou moins ambivalent du fait des efforts à fournir pour entrer en relation avec d’autres. On est plus ou moins bien disposé à accepter de se mettre à la place de stagiaire, d’apprenant. Surmonter cette résistance suppose d’accepter de renoncer à une « forme » déjà établie, à un état antérieur et aux bénéfices psychiques que cet état a fourni. Ceci, même si dans une autre partie de notre espace psychique, nous sommes insatisfaits de cet état. Bien sûr, tout cela procède autant de processus conscients qu’inconscients. À l’intérieur de chacune et de chacun, la psyché est multiple, complexe, contradictoire. Ce que nous voulons dans un sous-système de la vie psychique, nous pouvons le refuser dans un autre sous-système, tout cela à notre insu. Rien n’est simple, sinon, on s’en serait aperçu.
Une disponibilité à percevoir l’inadvenu, pour soi ou pour les autres
Un stage est fait pour provoquer une mise en mouvement volontaire, une nouvelle réceptivité, une disponibilité à l’inadvenu. C’est à cette condition qu’un stage peut favoriser une transformation d’un stagiaire qui forgera en lui de nouvelles possibilités, le préparera à des responsabilités ultérieures, en centre de vacances par exemple, ou dans l’enseignement, puisqu’au début de cette histoire des centres de vacances collectives pour des enfants d’âge scolaire ou préscolaire, qui est en même temps un peu l’histoire des CEMÉA et d’autres organismes de formation, c’est autour de 90 % environ des cadres et moniteurs qui étaient instituteurs ou se destinaient à l’être jusque dans les années dix neuf cent soixante dix. L’expérience du stage de base et de son encadrement a constitué pour nombre d’instituteurs une instance formatrice irremplaçable et irremplacée aux métiers de l’enseignement. La plupart s’en souvient toujours. Du fait des mutations accélérées de la société dans les dernières décennies du 20e siècle, les Pouvoirs Publics qui, après la Libération, ont soutenu ces dispositifs, se sont désengagés progressivement à partir des années dix neuf cent soixante dix. En 2008, ils se sont montrés bien disposés à donner le coup de grâce aux associations laïques d’éducation populaire et d’éducation nouvelle qui, depuis plusieurs décennies, prennent en charge de larges secteurs d’interventions sociales intermédiaires, pourtant si nécessaires au ressourcement des individus et des liens, à la préservation d’espaces de médiation que les jeunes générations, en mal d’intégration sociale, peuvent rejoindre. L’incroyable et continu amenuisement de cet engagement des politiques publiques et l’amputation conséquente des structures et espaces sociaux intermédiaires voués à l’intégration si complexe de la jeunesse notamment dans la société actuelle prend le sens d’une rupture du contrat social dans ses dimensions manifestes et implicites. Ce rétrécissement crée les conditions d’une désinstitutionalisation de la jeunesse. Or, il faut attirer l’attention sur le sens du terme instituer. Instituer veut dire mettre en état d’exister. Instituer, c’est faire exister socialement et politiquement dans la cité des êtres humains. Sommes-nous dans une ère, de refus de faire exister et de destitution ? L’instance centrale du pouvoir politique ne voulant plus assumer sa responsabilité sociétale vis-à-vis de la jeunesse dans son ensemble, la jeunesse exclue du processus social, une partie de celle-ci au moins, la plus vulnérable, n’est pas disposée à recevoir et à apprendre, puisque la contrepartie politique et socio-intégrative n’est pas assurée. À quelles conditions un stage peut-il être « formateur » ? C’est dans ce contexte, très sommairement décrit, que des stages de formation continuent d’être organisés, pour préparer des jeunes et des moins jeunes à des rôles éducatifs d’encadrement dans des centres de vacances collectives avec ou sans hébergement, ou à d’autres responsabilités d’encadrement éducatif, d’intervention ou de médiation sociale ou, par exemple, de remédiation scolaire. Mais, veut-on, autant qu’antérieurement, consacrer la durée incompressible nécessaire pour que les conditions de bases rendant possible un espace de formation soient instaurées, pour que des effets de formations soient produits ? On peut en douter. La mode est au « temps réel », à l’immédiateté, à la précipitation, à la performance, laquelle n’est mesurée qu’à l’aune d’unités fabriquées pour qu’elles soient additionnables et transformables en tableaux et graphiques. Peu importe que ces unités soient fictives et n’aient aucun rapport avec la réalité qu’elles prétendent représenter, qui est infiniment complexe ; pour que la réalité soit mise en conformité avec sa fiction, il suffit de croire à plusieurs que la réalité est ainsi figurée pour qu’elle tombe bien illusoirement dans l’escarcelle de notre maîtrise ; on peut alors croire que l’on contrôle les situations et le processus social. Nous sommes en pleine pensée magique, comme dans les sociétés anciennes, qui tenaient grâce à la conviction partagée que le mythe qui racontait le récit de ces sociétés, dont celui des origines avait un fondement de vérité, non pas une vérité de nature mythique, mais scientifique. Précisons que les mythes sont indispensables, à condition qu’on n’oublie pas qu’ils sont des mythes. Mais quand on se laisse prendre par la pensée magique, les réveils sont brutaux. Dans ce contexte, on observe que tout se passe comme si, il y avait un accord tacite et une pression explicite pour diminuer le temps passé en stage pour renoncer aux conditions propices à l’efficacité des dispositifs de formation. On entend, par exemple, que les stages coûteraient trop cher, alors que leurs prix sont bien en dessous de ce qu’ils coûtent. Tout se passe comme si on était devenu ignorant des conditions à instaurer pour qu’un dispositif de formation puisse être effectivement formateur. C’est pourquoi, il nous a semblé nécessaire de revisiter « les fondamentaux » d’un stage de formation, quelles que soient les responsabilités auxquelles il prépare.
Qu’est-ce qu’un stage ? L’histoire du mot stage et de son sens peuvent se résumer comme suit : ce mot provient du latin médiéval stagium et de l’ancien français estage qui désigne quelqu’un qui est arrêté, que l’on a arrêté dans un entre-deux qui le contraint à un séjour en période probatoire. Si cette période ainsi passée s’avère probante, le stagiaire peut ensuite accéder à la position reconnue pour laquelle il s’est préparé. Le stage est fait pour passer d’un avant à un après et pour changer de place dans le corps social et lui permet d’accéder, à des degrés variables, à un nouveau statut de reconnaissance sociale ou professionnelle, c’est-à-dire politique. De nos jours, le même mot stage inclut cette dimension mais d’autres aussi. Il désigne toujours cette période d’arrêt obligé de l’individu mis entre deux états et qui y séjourne. Il désigne aussi les dispositifs de formation eux-mêmes que les prédécesseurs déjà formés et intégrés au système social ou professionnel mettent en oeuvre pour rendre l’expérience du stage bénéfique pour l’individu. En outre, si l’accès à une reconnaissance de compétences nouvelles est possible grâce au stage et aux apprentissages qu’il facilite, de nos jours, l’intégration du stagiaire dans un nouveau statut, à l’issue de cette période n’est, quant à elle, pas assurée, même lorsqu’il a donné preuve de ses nouvelles compétences. D’où, comme nous l’avons déjà souligné, un facteur de résistance supplémentaire à l’entrée en formation. D’où sans doute aussi le symptôme d’une maladie politique de la société actuelle qui multiplie les haies et les évaluations, reculant toujours plus l’entrée dans la vie et rendant cette installation toujours plus précaire.
Un arrêt transitionnel entre deux états Se former cela veut dire travailler en vue de se donner une nouvelle forme ; il ne s’agit pas là d’un ravalement de façade, d’un changement de peinture superficielle sur son enveloppe corporelle, sur son visage, laissant intact ce qu’il y a à l’intérieur de soi. Se former, cela veux dire accepter d’entrer dans un processus de changement personnel. Comme on ne démarre pas informe mais en ayant une forme déjà acquise en des étapes antérieures de sa vie, une nouvelle formation implique l’abandon de formes antérieures. C’est bien là la difficulté : l’intériorisation d’un nouveau savoir, savoir-faire, ou savoir-être nécessite un renoncement aux savoirs déjà acquis non pour les évacuer complètement mais pour les remanier en les mettant en relation avec des savoirs nouveaux, mais ce peut être aussi pour les écarter complètement ou les ranger autrement dans sa psyché en les reconnaissant, le cas échéant, comme théories infantiles avec leur fondement fantasmatique, creuset de désirs et d’énergie. Cette opération suppose une période plus ou moins longue de suspension des certitudes et un dégagement des identifications qu’elles ont permises et qui font partie intégrante des repères d’identité et de notre personnalité. Apprendre suppose donc pour chacun une prise de risque, une mise en suspension, une période de relative fragilisation, pendant laquelle les repères habituels du jugement et d’une rationalité acquise sont mis à distance, libérant en soi une suffisante disponibilité et une suffisante énergie pour recevoir de nouvelles données, pour se laisser altérer par de nouvelles expériences et par ce que nous en éprouvons, pour élargir notre sensibilité même, pour augmenter notre territoire psychique, comme l’a écrit Nathalie Zaltzman dans son bref et bel ouvrage intitulé L’esprit du mal (2007) . Des règles de travail Cette nécessité peut être regardée d’un oeil suspicieux. Voudrions-nous fragiliser autrui pour le tromper, puis le manipuler ? Il n’en est rien, car les règles de travail d’un stage de formation sont énoncées explicitement et valables pour tout le monde, y compris ses formateurs qui les énoncent et sont chargés de les garantir. Tous y compris eux y sont également soumis. Un stage de formation est un espace social régi par les principes de la société de droit. Pour créer ces conditions intermédiaires, sans brusquerie, sans précipitation, en respectant les temps psychiques nécessaires, en permettant à chacun de reconquérir une capacité de patience, ce qui est contraire à l’esprit du temps, un stage doit avoir une durée minimum. Seule une durée minimum permet de se dégager de ses repères coutumiers, de saisir le sens des règles du jeu d’un stage de formation qui ne peuvent être entièrement identiques aux règles habituelles. C’est grâce à cette différence d’espace, de règles, de méthode, de tâche, de temps, que l’on peut, si l’on s’y investit, se rendre compte à quel point, les cadres sociaux coutumiers nous délimitent, nous limitent, nous restreignent, nous empêchent d’apprendre, nous font penser d’une manière socialement encadrée ou unique, nous aliènent, nous font ignorer à quel point nous sommes conditionnés. Soulignons qu’en même temps ces marquages sociaux sont indispensables, on ne peut faire sans, on ne tiendrait pas debout sans. C’est ce qui explique pour partie l’agitation constante de certains enfants ou adultes qui, par ce mouvement perpétuel, luttent pour ne pas s’effondrer, faute d’une colonne vertébrale culturelle du fait des insuffisances vécues dans les transmissions familiales et sociales. Et pourtant, de temps en temps, si l’on veut se développer, s’émanciper, reprendre contact avec nos potentialités créatrices, il est nécessaire de se mettre à côté, de se délivrer provisoirement de ce corset, si nécessaire en temps ordinaire. Sans ces pas de côté de temps en temps, sans se mettre à distance des emballement de la société hypermoderne qui est la nôtre, nous restons enfermés à l’intérieur d’un périmètre qui nous aveugle et nous soutient à la fois, et nous nous condamnons à refermer notre territoire psychique sur lui-même, sans lui donner la chance de s’augmenter grâce à de nouvelles rencontres, de nouveaux éprouvés, de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages.
Ramener au déjà connu l’inédit pour le supporter Le plus souvent, les conditions de la transmission ne font que susciter un autre processus par lequel, on se limite à déposer quelque part en soi de nouveaux « objets », en les laissant en suspension dans notre espace psychique ; ainsi déposés mais non liés, ils restent corps étrangers, comme si c’était des objets en recel, qu’on ne touche pas, par lesquels on ne veut pas se laisser toucher, comme s’ils étaient des toxiques, comme s’ils pouvaient nous corrompre. Les savoirs ne s’acquièrent pas de la simple accumulation. Apprendre, cela veut dire faire entrer en soi de nouvelles données et se transformer avec en les altérant créativement et sans les détruire. C’est à cette condition que l’on peut se sentir enrichi, fécondé par une nouvelle expérience, et actif dans un nouvel apprentissage, dans de nouvelles rencontres qui vont contribuer à constituer notre « soi ». Comme nous-mêmes, nous contribuons à la constitution du « soi » des autres, dès lors que nous entrons en relation avec eux et communiquons quelque chose de singulier, de différent, non pour humilier et rabaisser autrui, mais pour s’instruire mutuellement. Pour qu’il y ait cette disponibilité psychique interne chez les stagiaires, les dispositifs externes que constituent les règles du jeu d’un stage de formation, ses méthodes, ses démarches, doivent être suffisamment claires, comprises, réélaborées et portées par les formateurs pour que celles-ci puissent être investies par les stagiaires et qu’elles leur servent d’étayage externe et les aident à traverser les turbulences propres à tout travail de formation qui est un travail de changement. Ce qui suppose, du côté des formateurs un travail d’équipe patient, de telle façon que chacun s’approprie, comprenne le dispositif de stage adopté, ait quelques temps d’avance au moins sur les stagiaires. Sans cette reconnaissance préalable du côté des formateurs, sans cette acceptation d’une certaine suspension toute relative des cadres sociaux habituels, aux modes de pensée habituels et aux certitudes acquises, il n’y a pas de porosité psychique à l’inadvenu pour le sujet, pas de disponibilité pour recevoir des données nouvelles chez les stagiaires comme du côté des formateurs. Au contraire. On se crispe sur ce qu’on connaît déjà ou croit connaître. Si les conditions ne sont pas créées pour rendre possible chez le stagiaire et chez le formateur une nouvelle disponibilité, toute donnée nouvelle sera inaperçue, toute expérience nouvelle ne sera pas reconnue pour ce qu’elle est. Face à l’inconnu, le stagiaire et le formateur peuvent en effet lutter, chacun de leur côté et à leur manière, contre l’inconfort provoqué. Ne le supportant pas, ils sont tentés de tout ramener à du déjà connu. Faute de pouvoir percevoir l’inédit, l’être humain dépouillera l’environnement nouveau auquel il est confronté de toute qualité, pour le ramener à du déjà connu. Il dévalorisera l’actuel, pourtant non perçu, en affirmant qu’il sait déjà tout ça, ou bien, il déclarera que ce qui émerge ne présente aucune espèce d’intérêt ou d’utilité, ce qui lui permettra de rendre supportable cet environnement nouveau et justifier de son engagement. Soulignons que l’environnement d’un stage est créé par le dispositif conçu par les formateurs certes mais, pas seulement. L’environnement d’ensemble d’un stage qui s’installe se met immédiatement en mouvement, car il est la résultante du dispositif formel constamment bousculé par les modes d’investissement de tous les participants et par les luttes que chacun mène pour exister, influer sur le cours des choses, se protéger des tensions énigmatiques provoquées par les résonances entre les données qui lui viennent du dedans de lui-même avec celles qui lui viennent du dehors, du fait, notamment, de l’incertitude intrinsèque à l’entre-deux de la place de stagiaire. Aussi, ce qui advient en stage n’est pas ce qu’on a prévu. Un stage n’est pas une mécanique. C’est pourquoi, les formateurs ont intérêt à se donner chaque jour un temps pour échanger et pour élaborer autant que faire se peut ce qui advient afin d’accompagner le mouvement du groupe de formation, ses turbulences, d’en consolider sans rigidité le dispositif, pour laisser aux mouvements de la vie, la possibilité de se déployer, en neutralisant sans contre-violence son versant toujours possible de destructivité excessive. En articulation avec les contenus de formation, un stage est en même temps une expérience groupale, une expérience sociale et politique en marge des lieux familiers et des cadres sociaux habituels et c’est pour cela qu’elle peut s’avérer formatrice, transformatrice. Chacun, à son insu ou non, entre en groupe et en relation selon une modalité qui lui est propre. Par le mode d’entrée qu’il adopte, chacun espère prendre la place qu’il convoite d’occuper et dans laquelle il attend de se sentir bien à sa place dans le groupe social où il est. Ce qui provoque bien des heurts, car la place qu’on parvient à occuper dans un groupe ne découle pas de notre seul désir. Elle ne peut résulter que de multiples transactions au cours desquelles chacun se frotte au scénario des autres et accepte de laisser de la place aux autres, leur reconnaît un droit égal d’exister dans le groupe. Il y a du renoncement dans ces mouvements, mais, au bout du compte, si on y parvient, chacun peut arriver à s’aménager une place en relation et en interaction avec celles des autres, ce qui suppose d’accéder à l’idée, bien contraire aux idées reçues et à l’air du temps, que la liberté que chacun peut exercer n’augmente que si celle de chacun des autres augmente solidairement. La liberté est une propriété collective. Les rites de passage des sociétés traditionnelles avaient une finalité d’intégration sociale pour tous Un stage de formation offre un espace intermédiaire et potentiel (Sirota, 1998) , qui crée les conditions d’une possible mise en mouvement. Il s’organise de telle façon qu’il instaure un environnement nouveau et qui doit surprendre, afin que les modes d’être habituels des participants et stagiaires ne puissent s’avérer adaptés à la situation, sans les insécuriser de trop. Or, nos observations des individus et des groupes nous ont conduit à conclure que le mode d’être habituel en groupe de nombre d’êtres humains, montre qu’ils attendent de bénéficier d’une sorte de statut d’exception chacun à sa manière ce statut qui peut être même ouvertement revendiqué et légitimé. Le scénario d’entrée en relation, de prise de place et de parole en groupe que chacun déploie pour obtenir ce statut d’exception prend des figures diverses. Si les stagiaires qui s’engagent dans ce type d’espace groupal et social de formation prennent conscience de l’inadéquation de la situation avec leur mode d’être habituel en groupe et de l’inadéquation de celui-ci avec leurs propres idéaux conscients, ils se sentiront poussés à bouger psychiquement et à inventer de nouveaux modes d’entrée en groupe et en relation, moins défensifs, généralement, ce qui leur donnera accès à une nouvelle capacité, celle du plaisir partagé. Ce processus, socialisant, apprend à devenir sujet social, sujet politique, apprend à vivre avec les autres et non contre les autres. Un stage est donc un espace de passage microsocial. Ne garantissant plus l’insertion sociale, les espaces de formation doivent être propices à une maturation psychologique À la différence des rites de passage des sociétés appelées traditionnelles en socio-anthropologie, un stage, en tant qu’instance actuelle de passage, est sans doute essentiellement un lieu de transformations psychologiques. Ces rites en effet étaient conçus selon un rituel très organisé et débouchaient nécessairement sur une consécration définitive des jeunes gens et de jeunes filles comme adultes parmi les adultes . Il y avait une mutation statutaire organisée. À l’issue d’un dispositif de formation ou d’insertion actuel auquel il a participé, un jeune ne trouve pas aussitôt un lieu de reconnaissance et d’insertion professionnelle, une statufication sociale. L’efficacité d’un stage aujourd’hui ne peut être éprouvée que s’il prend pour ses participants, sur le seul plan subjectif, valeur d’instance de passage, grâce à une expérience psychique et culturelle de conciliation entre rupture et continuité. Ainsi s’acquiert la patience et la capacité d’aller vers la société pour chercher à y prendre place, même quand celle-ci n’organise plus, à son initiative et pour tous, de rituels d’insertion et de reconnaissance. D’où, une plus grande incertitude et une plus grande responsabilité individuelle et familiale. Au delà de ses contenus particuliers, un stage peut, si on le veut, fournir l’occasion d’une expérience culturelle positive voulue par la société mais aux marges de celle-ci, où pourraient coexister, sans conflits exacerbés ni effondrement irrépressibles, le déjà là à remettre en cause et le potentiel non encore advenu. Il peut être un lieu de transition permettant à chaque jeune de se resituer par rapport à ses héritages culturels, non pour les effacer, les répudier ou les trahir, mais pour qu’il parvienne à les contenir autrement en lui. Cette reliaison avec le passé est indispensable pour déclencher une certaine mobilité énergétique favorable à de nouveaux investissements. C’est pour quelques uns l’occasion de commencer à croire en soi en cessant de se regarder comme « rejeton » de l’humanité, assignation dont beaucoup d’enfants ont été inconsciemment lestés par leurs parents ou par des représentants de la société que l’enfant, le jeune rencontre à l’école. Le mérite de chacun dépend des capacités collectives et réciproquement Un stage ne peut contribuer à produire ces effets que dans la mesure où il crée les conditions d’une expérience pour chacun de sa subjectivité et de celle des autres dans un climat de confiance et d’écoute, ce qui permet d’apercevoir ce qu’est la subjectivité, la différence et en même temps la condition humaine que nous partageons. Il peut permettre d’éprouver l’illusion réconfortante et nécessaire que la vie vaut la peine d’être vécue parce que le monde où nous vivons ne reste un chaos absurde qu’autant que nous renonçons à parler ensemble pour lui donner sens. Le monde en effet, en dépit de ses nombreuses failles, est le résultat complexe et de données innombrables qui s’entrechoquent et se réorganisent constamment produisant à la fois discontinuités et possibles continuités, mais sans intentionnalité « naturelle ». Ce mouvement toujours critique est à déchiffrer entre ruptures et reprises transformatrices successives, entre le hasard et la nécessité ; les processus qui sous-tendent ces mouvements ne sont pas aisément intelligibles et pour une part nous échapperont toujours. Certes, l’expérience des groupes fait d’abord et souvent vivre l’épreuve de la multiplicité des modes d’être au monde et une certaine incommunicabilité. Devant les sentiments d’incompréhension, à l’expérience des groupes où l’on parle avec d’autres en s’y confrontant, on peut préférer des groupes où règne l’illusion trompeuse d’être semblables les uns aux autres ; d’où, soit le recours aux religions, aux intégrismes, aux sectes ou aux drogues dont on croit qu’elles conduisent à un monde harmonieux et sans conflit, au nirvana. Mais on peut aussi se réfugier dans l’individualisme ou dans l’exil intérieur. Or prenons garde à l’idéologie dominante qui nous fait croire à la seule existence du mérite strictement personnel et en définitif à la malfaisance des groupes, sinon des organisations sociales et même de ce que l’on appelle l’État ; c’est ce que nous distillent chaque jour les sirènes qui nous chantent qu’avec moins d’État tout ira mieux. L’effondrement du système financier international en 2008, qui a appelé le secours des États inflige un démenti de réalité, que d’aucuns s’empresseront bien vite d’oublier. Si nous avons chacun un mérite individuel, nous le devons à ce que les générations précédentes ont construit, aux autres, à ce qui nous stimule en provenance des autres et grâce à ce que nous avons su recevoir et faire fructifier en nous. Ce que nous sommes, nous le devons autant aux travail des autres qu’à notre propre travail, le mérite est donc toujours partagé, c’est ce qui fait lien. Isoler le mérite par individu et en faire une sorte d’entité indépendante traduit l’ignorance de la dimension toujours collective de notre patrimoine et relève d’un déni de réalité et d’une attitude asociale sinon antisociale. Cependant, l’épreuve de cette multiplicité des subjectivités peut déboucher sur autre chose que le sentiment du chaos et de l’absurde. La prise en compte de la multiplicité et de la complexité suppose une reconnaissance de ce que Janine Puget appelle « les mondes superposés », où monde intrapsychique et intime, monde intersubjectif à plusieurs et monde commun aux différents membres d’une communauté sont mis en tension, en tensions énigmatiques. Ces prises en compte sont indispensables à la formation et à l’adaptation de l’individu au monde moderne et à sa capacité à s’y repérer et à s’y situer, à y agir. L’expérience du travail de formation et de parole avec d’autres et en groupe en constitue certainement un passage nécessaire pour y accéder. L’idéologie individualiste qui prévaut de nos jours peut conduire à ne proposer que des parcours individualisés, des tranches de stage de formation, sans jamais de participation et d’engagement durables dans des espaces sociaux. Cela va de paire avec une pseudo-civilisation du nomadisme, du zapping, une valorisation de l’impermanence et de l’inconsistance. L’individualisation de la formation en formation initiale est un piège et une façon d’empêcher les liens, les identifications, et donc les effets de formation. Pour aller vers l’acceptation des différences, une identification et une autonomie personnelles, il est nécessaire de connaître ou d’avoir connu l’expérience d’un « bon groupe » ou d’un lien social positif. C’est, pour beaucoup, une expérience inédite. Les seuls liens éventuels de solidarité que nombre de personnes ont vécu se sont en général noués en opposition à la société ou en marge de celle-ci et tout en développant contre elle et contre eux-mêmes des conduites plus ou moins destructives. « Nous savons, écrit René Kaës , que l’enfant n’aura accès à la nécessaire différenciation que si l’expérience décisive de l’illusion a pu (se produire et) se reproduire. Le temps de la désillusion et l’avènement de l’espace transitionnel permettent l’exploration, par le jeu, des objets, des autres et de soi, dans l’entre-deux où fluctuent puis s’établissent, en un lien paradoxal « accepté et non-résolu », les limites entre le dedans et le dehors, le Moi et le non-Moi, le mien et le non-mien. La symbolisation et la créativité introduisent à l’expérience culturelle, » si nous avons un lieu où mettre ce que nous trouvons », (D.W. Winnicott ).
Les CEMÉA ont une longue expérience des stages. Nous avons à refuser et pas seulement à résister à l’air du temps et aux formes de pensées à la mode qu’il distille et qui laissent entendre que l’illimité est possible, que l’on peut tout savoir et tout de suite en appuyant sur une touche de clavier d’ordinateur, que l’on peut tout savoir sans s’engager avec une continuité certaine dans un processus et dans un ensemble social. Le moment est peut-être venu de nous réunir nous-mêmes en session de formation afin de remettre le stage sur le métier, de revisiter ce qu’il permet, d’en ré-appréhender les dimensions, les potentialités, les fondamentaux et les complexités. On oublie vite quand on est pris par la routine, les pressions idéologiques et financières. C’est une voie à redécouvrir en parlant ensemble dans des espaces de réélaboration appropriés, afin que les formateurs des CEMÉA redonnent au stage, leur joyau, toute sa portée possible.



